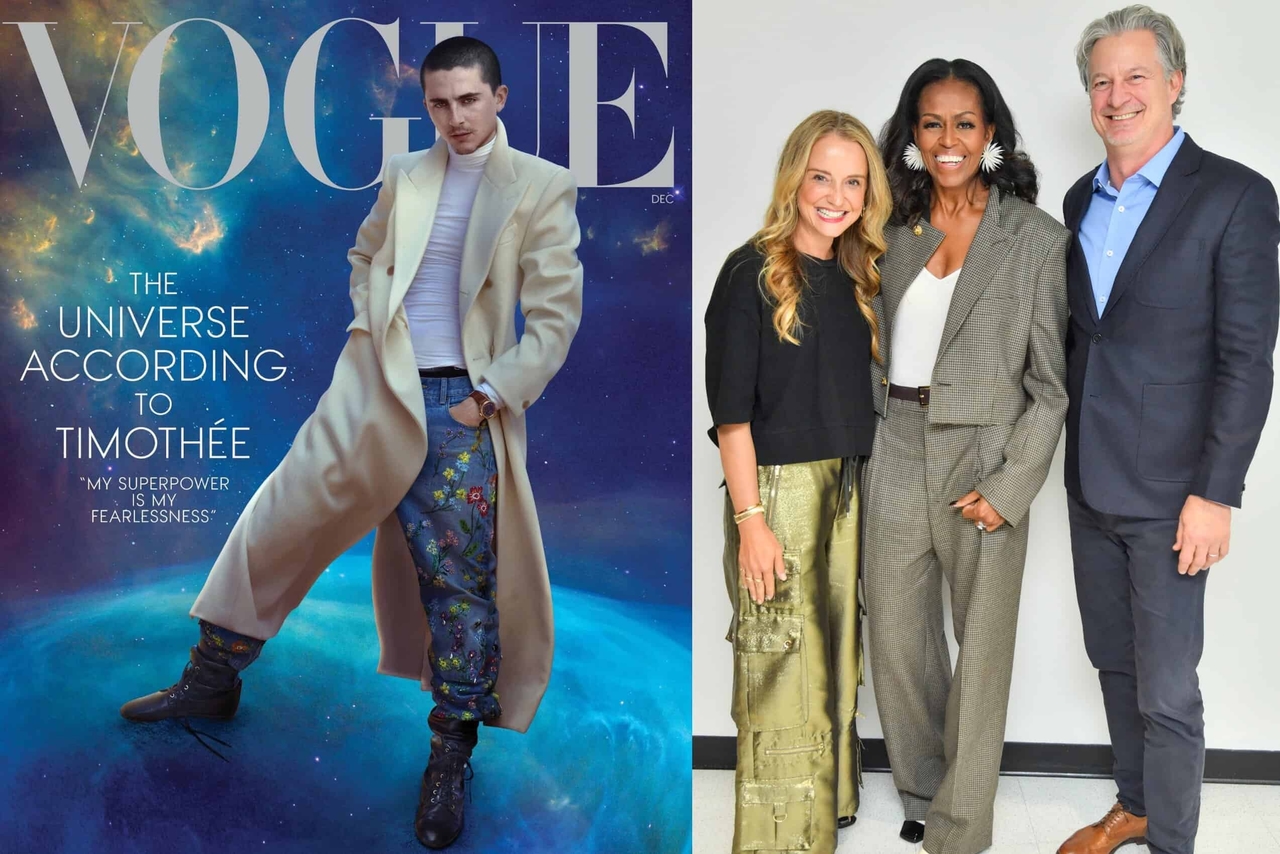L'élégance est une forme de calme. Parole de Giuseppe Ignazio Loi.


Photo Ansa
la feuille de mode
Comment obtenir de nombreuses vérités sur la mode révélées par un homme de quatre-vingt-cinq ans qui a toujours été berger et qui, depuis deux mois, est très recherché sur les podiums et les tapis rouges, témoin d'Antonio Marras et protagoniste de "La vita va così"
Il existe des visages que le vent semble avoir façonnés plutôt que le temps. Celui de Giuseppe Ignazio Loi , quatre-vingt-quatre ans, berger de Terralba, village situé à vingt kilomètres d'Oristano, appartient à cette lignée d'hommes qui ne se déplacent pas pour arriver, mais pour rester. Un jour, la mode et le cinéma s'intéressèrent à lui, mais au lieu de le transformer, ils furent transformés par lui ou, d'une manière ou d'une autre, influencés par lui. Son visage, émacié et serein, est au cœur du nouveau film de Riccardo Milani, « La vita va così », produit par Medusa Film et PiperFilm et plébiscité par le public. Le film s'inspire de l'histoire d'Ovidio Marras, le berger qui s'opposa pendant des années à la construction d'un gigantesque village touristique près de la plage de Tuerredda, en Sardaigne . Loi incarne Efisio Mulas, l'alter ego de Marras, aux côtés de Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari et Virginia Raffaele. C'est la deuxième fois qu'elle incarne une femme luttant pour la défense de la société rurale, après le succès retentissant d'« Un monde à part », qui a sans doute inspiré Milani pour écrire un scénario parallèle, avec la même actrice dans le rôle principal. Mais pour Loi, avant même le cinéma, il y avait la mode.
Lors du défilé printemps/été 2026 d'Antonio Marras à Milan, dans les anciens Magazzini Generali, un décor de montagnes de sable, de sel et de livres évoquait le voyage entrepris en janvier 1921 par l'écrivain D.H. Lawrence et son épouse Frieda von Richthofen, la « Reine des abeilles » de sa correspondance abondante, le long des côtes et à l'intérieur des terres sardes, un périple immortalisé dans leur journal « Mer et Sardaigne ». Dans ce cadre, réinterprétant un épisode historique aux accents de légende, ou de spectacle théâtral devenu la signature du créateur sarde, Loi fit son entrée d'un pas lent mais déterminé, vêtu d'une veste vert olive brodée à la main, avec pour seule ambition d'être reconnu et validé comme le berger qu'il est. Et avec lui, sur le podium, arrivaient les montagnes, les pâturages, les mains rudes et les saisons – la Sardaigne la plus profonde, non pas celle des cartes postales, mais celle qui perdure. Son voyage devint ainsi une liturgie laïque, un acte de restitution. Marras l'éleva au rang d'ambassadeur d'une beauté qui ne se mesure pas en mètres de tissu, mais en centimètres de vérité : une beauté qui ne se photographie pas, mais s'écoute . Dans ce geste, dans l'apparente simplicité d'un homme qui traverse l'espace du luxe sans s'y laisser engloutir, il y avait un message, car, comme nous le savons, la mode peut être politique, poétique et civique, un espace de préservation, non de consommation. À la fin du défilé, Marras et Loi saluèrent ensemble le public, tandis que résonnait dans l'air « Questo nostro amore » de Rita Pavone, choisi comme bande-son finale. L'instant, suspendu et si doux, finit par transformer le podium en un récit, la lenteur du berger en une mesure du temps et la beauté en un souvenir. « Pour moi, c'était une robe comme une autre », a déclaré Loi à « Foglio della moda » avec un sérieux absolu. « Je ne me sentais pas déplacé, au contraire. Je me suis dit : je vais simplement marcher, comme je l'ai toujours fait. L'élégance, si elle existe, est une forme de sérénité. » Quelques semaines plus tard, avec la même nonchalance, il foulait à nouveau le tapis rouge du 20e Festival international du film de Rome, où « Life Goes That Way » faisait l'ouverture. Lorsque nous l'avons rencontré, il était clair que l'idée même d'être vu lui était étrangère. « Je ne comprends rien à la mode », a-t-il souri, en exhibant sa veste de velours noir à fleurs. « Le tissu me fait penser à nous autres Sardes, mais on ne s'habille pas comme ça, même si j'en aurais envie. » Marras m'a promis qu'il m'en ferait un. » Il ajoute : « Ma vie a toujours été partagée entre la maison et le travail, ou plutôt, entre la campagne et la campagne : pour moi, les vêtements ne sont que des chiffons nécessaires », ignorant que, depuis au moins un demi-siècle, c'est devenu une habitude chez les fashionistas de parler ainsi des vêtements. Plutôt que de jouer la comédie, Loi a préféré « habiter » son personnage, et à l'écouter raconter, cela semble avoir été très simple. « J'ai lu le scénario, mais je ne me suis pas forcé à tout apprendre par cœur. C'était instinctif. Je suis berger depuis soixante-dix ans : soit on ressent la terre, soit on ne la ressent pas, ça ne se simule pas. Alors j'ai joué avec les mots que j'avais envie de dire, sans prétention. Puis j'ai reçu un appel d'un cousin à Terralba qui m'a mis en contact avec l'équipe de Riccardo pour les auditions, et c'est ainsi que cette belle histoire a commencé. »
Après l'avoir observé, le réalisateur l'a immédiatement voulu, pressentant que cet homme, avec ses silences et ses gestes essentiels, incarnerait la justesse recherchée par le film. « C'était tout à fait naturel, je me suis beaucoup amusé », poursuit Loi. « La scène qui me reste en mémoire est celle où ils me proposent de me vendre le terrain et où je refuse. À ce moment-là, je me suis revu. Quand je dis non, c'est définitif. » Dire non, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, lui faisons-nous remarquer. Et lui : « Pour moi, c'est tout le contraire. Dire non est facile ; c'est ma façon d'être libre. »
Après le tournage, la célébrité lui est venue avec Abatantuono, qui l'a surnommé « le De Niro de Terralba ». « Au début, j'ai cru qu'il plaisantait, puis j'ai compris qu'il était vraiment content de mon travail », confie Loi, qui a été ému à plusieurs reprises lors de l'avant-première romaine. « Les flashs sur le tapis rouge étaient si intenses qu'ils m'ont aveuglé. En allant au cinéma, j'ai fermé les yeux et ces lumières ressemblaient à des étoiles. J'ai eu les larmes aux yeux trois ou quatre fois. Quand les applaudissements ont commencé, je n'en croyais pas mes yeux. Je crois que je regarderai le film tous les jours, même s'il est déjà gravé dans ma mémoire. » Pourtant, derrière cette émotion, se cache un homme qui refuse de se laisser éblouir. « Demain, je retourne à la campagne », a-t-il déclaré après le dîner de gala à l'hôtel St. Regis. Et il a tenu parole, décevant au grand dam des organisateurs de petits-déjeuners et de dîners en ville, à Parioli ou sur la Voie Appienne, qui, dans ce jeu pas si cruel des mondanités, « Je l'ai/Je ne l'ai pas », auraient grandement apprécié la présence de ce berger typique. « Ma maison est au milieu des champs, et j'y suis heureux, entouré de mes chats et de mes plantes ; le grenadier est mon préféré. Je vis seul, avec seulement ma sœur et une nièce qui habite à Cesenatico. Si je suis en compagnie, je suis heureux, mais si je suis seul, je le suis tout autant. Je ne manque de rien : j'ai ma pension et un peu d'argent du film, mais ce n'est pas l'essentiel. » Le paysage qui se lit sur son visage semble embrasser tout le Campidano, la plus grande plaine de Sardaigne, avec son vent, ses pierres et sa lumière changeante au fil des heures. Lorsqu'il prononce « Custa est domu meu » dans le film, Loi ne défend pas une frontière, mais un équilibre fragile et sacré entre l'homme et la terre. Son parcours, du troupeau aux plateaux de tournage, de la campagne aux podiums, nous en dit bien plus qu'on ne l'imagine. Dans un monde qui idolâtre la visibilité, il incarne la force de la discrétion, car il est un homme qui entre dans le cercle de la célébrité sans s'y fondre. Sa force réside dans la sobriété, dans sa capacité à rester immobile, même lorsque tout autour de lui est en mouvement. « Mon métier m'a appris que le courage est une affaire de caractère », dit-il. « Enfant, j'en avais beaucoup, et je ne l'ai jamais perdu. C'est ce qui me permet de tenir bon, comme un mouton dans la tempête. » Dans sa manière d’être au monde, nous reconnaissons cette « simple profondeur » dont parlait Merleau-Ponty : la vérité qui résiste au bruit.
Plus d'informations sur ces sujets :
ilmanifesto